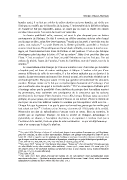Page 86 - Fabio Gasti (a cura di), Seneca e la letteratura greca e latina. Per i settant’anni di Giancarlo Mazzoli, Pavia, Pavia University Press, 2013
P. 86
74 Mireille Armisen-Marchetti
humiles amici, il ne faut pas oublier de prêter attention au terme humiles, qui révèle que
Sénè-que ne modifie pas la hiérarchie de la domus. L’universalité de la définition éthique
de l’amitié ne fait pas disparaître, mieux, ne remet pas en cause la réalité des classes
sociales. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette idée.
Le dernier qualificatif enfin, conservi, est aussi le plus choquant pour un lecteur
contemporain de Sénèque. De fait il renvoie au célèbre paradoxe stoïcien selon lequel
52
seul le sage est libre, solus liber inter ingenuos, tandis que les stulti, c’est-à-dire tous les
53
autres, sont esclaves. La seule liberté est la liberté spirituelle, accessible à l’esclave
comme à tout homme. Et symétriquement la servitude véritable, commune à tous les non-
sages, est l’asservissement aux biens de Fortune et aux passions. C’est ce que Sénèque
développera plus loin dans la lettre: «“C’est un esclave”. Mais il est peut-être libre par
l’âme. “C’est un esclave”. Lui en fera-t-on grief? Montre-moi qui ne l’est pas: l’un est
esclave du plaisir, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambition, tous de l’espoir, tous de la
54
crainte».
Le conservitium selon Sénèque (si l’on nous autorise à user d’un terme que lui-même
n’emploie pas) est donc de nature ontologique et éthique. L’esclave n’est pas d’une
essence différente de celle de son maître, il a les mêmes aptitudes que ce dernier à la
morale; il peut tout comme un homme libre devenir un ami, et la servitude véritable est la
servitude spirituelle. Mais pour autant il n’est pas question de bouleverser les structures
sociales. Sénèque insiste sur le fait que sa représentation humaniste de l’esclavage n’est
55
pas à confondre avec un appel à la révolte servile. Et l’on remarquera d’ailleurs qu’il
n’envisage même pas la possibilité d’une abolition de principe dont les maîtres seraient
les promoteurs, mais seulement une conséquence de la conscience que les esclaves
prendraient de leur statut d’êtres humains. Et en effet, lorsque Sénèque passe au conseil
pratique, au praeceptum, son enseignement s’énonce en ces termes: «Voici le résumé de
ma leçon: vis avec ton inférieur comme tu voudrais que ton supérieur vécût avec toi…
Chaque fois que tu penseras à ce que tu peux sur ton esclave, pense que ton maître peut
56
tout autant sur toi». L’esclave est un homme, et comme tel il fait partie de la société.
Néanmoins son état de subordination n’est pas remis en cause. Bien au contraire, la
société que se représente Sénèque est bien la société de l’Empire, hiérarchique et
pyramidale, où chacun, à l’exception du prince, a un supérieur. L’esclave n’est pas à
l’extérieur de la société, il est une pièce de cette construction – ce qui est déjà beaucoup –
mais n’en occupe que le degré le plus bas.
52 Sen. epist. 44,6 (Sénèque s’adresse à Lucilius) puta itaque te non equitem Romanum esse, sed libertinum:
potes hoc consequi, ut solus sis liber inter ingenuos. Sénèque a en quelque sorte préparé la Lettre 47 par la
Lettre 44: il faut se rappeler que les epistulae ad Lucilium ne sont pas à considérer chacune isolément, mais
que le corpus constitue une oeuvre cohérente et dynamique, orientée par un projet didactique et parénétique.
53 Cfr. SVF III 355; 360; 364; 591; 593; 597; 599; 603, et Cicéron, parad. 33-41.
54 Sen. epist. 47,17 “servus est”. Sed fortasse liber animo. “Servus est”. Hoc illi nocebit? Ostende quis non
sit: alius libidini servit, alius avaritiae, alius ambitioni,
ille turpiter dives et ille multorum dominus sed plurium servus; et pour d’autres textes, Armisen-Marchetti
(1989, pp. 113-115 et notes afferentes).
55 Sen. epist. 47,18.
56 Sen. epist. 47,11 haec tamen praecepti mei summa est: sic cum inferiore vivas quemadmodum tecum
superiorem velis vivere… Quotiens in mentem venerit quantum tibi in servum
tantundem in te domino tuo licere. Même idée dans clem. 1,18,1.